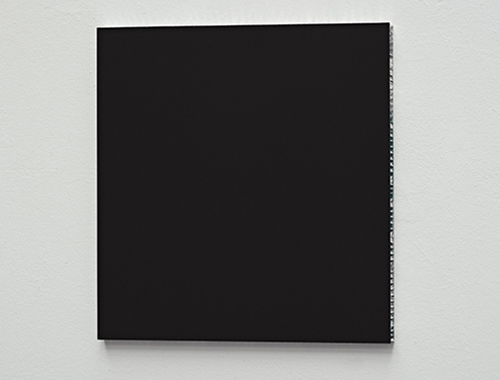NOIRS
1992-1994
Black pigments and binder on Aerolam M-Board
15.7 x 15.7 in / 40 X 40 cm ; 23.6 x 23.6 in / 60 x 60 cm ;
31.5 x 31.5 in / 80 x 80 cm ; 47.2 x 47.2 in / 120 x 120 cm
Noirs de noirs
Comme on dit « blancs de blancs ».
Rien de plus tentant, quand on doit parler de peinture monochrome, que d’engager d’entrée de jeu le discours théorique qu’appelle le paradoxe de la table rase, le paradoxe qu’il y a à faire la peinture en éliminant à peu près tout ce qui, « normalement », la fait : le contenu narratif bien sûr, mais aussi la composition, les rapports de couleurs et de valeurs, l’espace et son articulation, le jeu des formes et celui des lumières et, last but not least, tout renvoi, explicite ou non, au corpus de la tradition : bref, le discours sur le paradoxe d’une peinture faite en faisant le vide.
Or, même lorsqu’elle ne veut être, comme dans les « White Paintings » des débuts de Rauschenberg, qu’une surface blanche offerte au jeu de reflets et d’ombres de la vie qui passe, une peinture monochrome n’est jamais un vide. Elle dit toujours au moins un faire, même : elle ne dit rien d’autre qu’un faire : le peindre, et la volonté, en faisant, de poser, c’est-à-dire de donner à voir, la question du sens de ce faire, la question de ce que signifie, aujourd’hui faire la peinture. Comme de toute la peinture qu’elle met ainsi en question, d’une peinture monochrome on doit donc d’abord chercher à dire de quoi et comment elle est faite.
Les décisions que prend un artiste peignant un monochrome ne diffèrent pas dans leur principe de celles que requiert traditionnellement le métier de la peinture : choix d’un matériau destiné à former support ; choix des trois dimensions et du format de ce support ; choix d’un pigment et d’un ton (à la différence de la peinture polychrome, dans le cas du monochrome il n’y a choix que d’un seul pigment et d’un seul ton, à moins que le ton final ne doive être obtenu par la superposition de plusieurs tons) ; choix enfin d’un mode d’application du pigment sur le support. Ces décisions sont coordonnées de façon d’autant plus rigoureuse qu’elles doivent aboutir à ce que, toute trace d’image étant éliminée, un champ unique de couleur parfaitement homogène et de même dimensions que son support matériel fonctionne pour le spectateur (pour employer une expression aussi neutre que possible) en « unité iconique » véhiculant une signification spécifique.
Nicole Hassler choisit un support rigide, lisse, mais accrochant le pigment, assez mince pour être perçu comme un plan et non comme un objet tri-dimentionnel, et cependant assez épais pour bien se démarquer du mur, les chants doivent tracer de façon nette la limite de la surface peinte (actuellement, elle utilise des panneaux nid d’abeille de 14 mm d’épaisseur). Le seul format dont elle se serve est le carré : le carré non seulement équilibre verticale et horizontale, mais permet aussi au mieux d’annuler les polarisations qui peuvent se produire à l’intérieur de tout champ de couleur d’une certaine étendue, même si le champ est parfaitement homogène dans son ton et dans sa facture. Les dimensions sont variables, mais normalisées, soit 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 120 x 120 cm. Les quatre types d’objets qu’elles définissent correspondent donc à des situations de travail (pour l’artiste) et de vision (pour le spectateur) différentes les unes des autres ; surtout, elles jouent un rôle important dans la qualification du ton, la « qualité du ton perçu – on le sait depuis longtemps – étant étroitement liée à l’étendue de la surface que ce ton occupe.
Le pigment est choisi parmi ceux qu’offre le commerce, et appliqué sans mélange. Le mode d’application est très étudié, l’exécution minutieuse. La couche de peinture doit être mince et parfaitement régulière. Les pinceaux, qui pourraient trahir une écriture personnelle ou introduire des accidents de facture, même minimes, sont bannis, tout comme les rouleaux ou le pistolet, qui aplatiraient ou volatiliseraient le grain de matière picturale. Nicole Hassler emploie des brosses larges et souples, qui excluent tout effet et permettent d’étaler la couleur sans l’écraser. La couleur est appliquée en plusieurs passages, et poncée légèrement après séchage, avant que soit passée la couche suivante. Nous sommes plus près des techniques de laquage des artisans extrême-orientaux que du « faire » pictural tel qu’on l’entend traditionnellement l’artiste d’occident.
Le choix décisif est évidemment celui du ton. Chez Nicole Hassler, il s’agit toujours d’un noir, plus précisément de l’un des quinze à vingt noirs que les fabricants désignent comme tels dans leur catalogues : elle les emploie l’un après l’autre, mais de façon non systématique. Après les avoir expérimentés, elle a en effet écarté tant les couleurs du spectre que les terres, non pas pour se concentrer sur d’autres données de la peinture que la couleur, mais au contraire pour libérer la perception de la couleur de toutes les associations subjectives et flottantes que suscitent les couleurs et qui rendent cette perception incertaine et instable. Le noir n’est pas pour elle une non-couleur, encore moins, comme il l’était pour Malévitch, le signe conventionnel de la totalité des couleurs, mais la couleur la plus stable. C’est aussi la raison pour laquelle elle l’a préféré aux deux autres soi-disant non-couleurs, le gris et le blanc.
Théoriquement, du moins lorsqu’il est obtenu par le mélange d’un noir et d’un blanc réputés purs, le gris est neutre : ni chaud, ni froid. En fait – un travail comme celui d’Alan Charlton l’a magnifiquement montré – l’éventail des gris : depuis les grisés les plus pâles jusqu’aux gris anthracite presque noirs, est si largement ouvert qu’il est exclu d’y localiser « le » gris qui pourrait servir de valeur stable de référence. Exit donc le gris. Et le blanc subit le même sort.
Les catalogues recensent, paraît-il, plus de mille huit cents nuances de blanc. A quoi il faudrait ajouter les blancs sauvages, concoctés individuellement. Mais il y a plus. Non seulement chaque ton de blanc possède sa luminosité propre, mais cette luminosité varie constamment, en dehors de tout contrôle. Suivant les conditions dans lesquelles il est vu – avant tout, bien sûr, les conditions d’éclairage – un même blanc peut soit rayonner, « venir en avant » et dilater la surface qu’il recouvre, soit au contraire s’éteindre, « reculer », se rétracter et faire paraître cette surface plus petite qu’elle est en réalité. La perception de la limite réelle de la peinture devient ainsi quelque peu hésitante, il se produit un flou qui, si léger qu’il soit, tend à découpler de la perception de la réalité d’un objet-peinture l’illusion d’un espace pictural autonome par rapport à cet objet (cette incertitude ne disparaît que dans les monochromes blancs de très grand format et/ou lorsque les chants sont eux-mêmes peint en blanc). Le blanc ne fonctionne donc pas différemment des autres couleurs, et c’est pourquoi Robert Ryman a pu choisir de s’en tenir au blanc pour mener son enquête, qui porte non pas sur le monochrome blanc, mais sur les propriétés et la perception de l’espace imaginaire que fait naître la couleur peinte en général. Pour Nicole Hassler, il est en revanche indispensable d’éviter que se produise la moindre interférence entre la perception immédiate de l’objet et la suggestion parasite d’un espace d’illusion. Paradoxalement en effet, elle doit assurer une parfaite stabilité de la perception de la couleur comme réalité matérielle de la peinture pour faire apparaître, ainsi qu’elle se l’est fixée comme objectif, l’ambivalence de cette perception même.
Il était donc dans la logique de sa démarche que Nicole Hassler choisisse le noir. Mais il y a noir(s) et noir(s). Le rejet des « noirs de couleurs », obtenus par le mélange ou la superposition de plusieurs couleurs, et l’emploi exclusif des noirs de noirs, c’est-à-dire des pigments désignés comme noirs d’origine par les nomenclatures techniques, s’imposaient. Ce ne sont pas là de simples détails de métier, mais des choix qui traduisent dans le faire les options fondamentales de l’artiste.
Il en allait d’abord de la qualité, ou, plus précisément, de la qualification du ton. De façon sans doute furtive, mais singulièrement efficace, les « noirs de couleurs » laissent en effet transparaître la diversité et la richesse des tons dont ils sont faits : rouges, bleus, bruns, verts… Dans les « Ultimate Paintings » d’Ad Reinhardt, paradigmatiques à cet égard, les étendues de noir à première vue homogène se révèlent à un regard attentif être non pas monochromes, mais configurations géométriques de tons très divers, rapprochés les uns des autres par des mélanges les obscurcissant progressivement, jusqu’à converger et se confondre presque, à la limite du noir, mais en laissant chacun entrevoir le souvenir de sa « qualité » première, en tant que rouges, bleus, bruns ou verts.
Dans les monochromes « noirs de noirs » au contraire, jamais et nulle part n’apparaît le moindre soupçon d’une modulation tonale. Suivant son origine, le ton est plus ou moins saturé, plus ou moins en surface ou en profondeur, plus ou moins satiné ou mat, plus ou moins dense ou translucide, mais, sur toute l’étendue de la surface qu’il recouvre, il reste identique à lui-même, d’une égalité et d’une permanence inébranlables. De plus, peints (avec combien d’attention), les noirs de noirs de Nicole Hassler ne réagissent sans doute pas tous de la même façon à la lumière : certains l’absorbent, d’autres semblent, paradoxalement, l’émettre. Cependant, toujours ils la contrôlent, ils la font percevoir non dans l’instantanéité, l’instabilité de la vibration lumineuse, mais dans l’immobilité d’une contemplation qui n’en appelle pas à la sensibilité en tant qu’évocation du souvenir ou du désir d’expériences autres, mais qui renvoie exclusivement – au noir…
… En présence des noirs de noirs de Nicole Hassler, déchargé du souci de déchiffrer une image et à l’abri de tout brouillage parasite, le regard peut / doit de même se faire écoute, écoute du silence. Suffisamment attentif, il ne tardera pas à découvrir que le carré peint noir auquel il est confronté n’est ni sur un mur aveugle et muet, ni un vide abyssal, mais un espace dans lequel, en lui donnant à voir la sonorité, pardons la qualité indicible de tel noir, et rien de plus, le monochrome lui suggère pourquoi et comment, aujourd’hui (quelque part entre Wittgenstein et John Cage), peinte seule, une couleur peut créer le sens, et qu’elle l’invite à en faire lui-même une peinture.
Extrait du texte : Noirs de noirs, Maurice Besset, in catalogue : Nicole Hassler, 1993